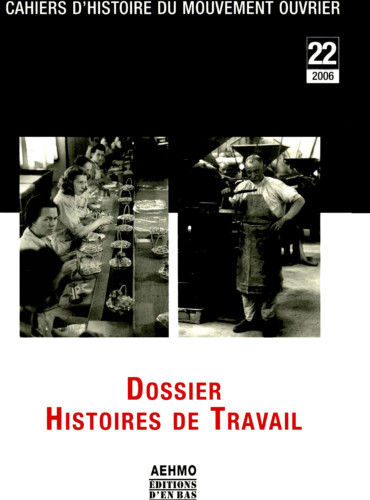
Cahier n°22. Histoires de travail
AÉHMO & Éditions d'en bas.
2006, 191 p.
Présentation
Dans un livre qui devint rapidement un best-seller et qui parut en français en 1997, Jeremy Rifkin annonçait à terme «la fin du travail» dans la plupart des pays industrialisés. Tablant sur l’incapacité des nouvelles industries (informatique, biotechnologies, etc.) à combler la diminution, par suppression ou délocalisation, des emplois dans les industries nées de la Seconde Révolution industrielle, l’économiste américain concluait implacablement à l’émergence dans le courant du XXe siècle d’une population majoritairement formée d’inactifs, seule une petite minorité d’heureux élus restant occupés. Le travail disparaissant, ce que Karl Marx avait décrit au XIXe siècle comme une armée de réserve de main-d’œuvre dans laquelle le patronat piochait au gré des besoins deviendra aux yeux de Rifkin une armée d’inutiles sans peu d’espoir de (re)trouver un travail, à charge des services sociaux de l’État ou de la charité privée. Les angoisses de Robert Linhart exposées en exergue n’auront dès lors plus lieu d’être sous cette forme, les angoisses de la survie les ayant remplacées. A l’hypothétique société de plein emploi dont on ne cesse de rêver depuis les années fastes des Trente Glorieuses succéderait une société de sans-emploi, seule issue à un système incapable de maîtriser les progrès technologiques qu’il génère et victime de sa propre raison de vivre, le profit. La seule question demeurant centrale serait celle de savoir si les richesses dégagées par les nouvelles industries permettront d’assurer l’existence des sans-emploi.
(Extrait de l’introduction).
Sommaire
- Laurent Tissot, Introduction, (pp. 3-9)
- Les conditions de travail
- Johann Boillat, Entre discipline et sécurité : la gestion du personnel dans la compagnie ferroviaire du Jura Industriel (1857-1865), (pp. 10-32)
- Carine Cornaz, Aller à la mine : main-d’œuvre et conditions de travail aux Mines et Salines de Bex dans la première moitié du XIXe siècle, (p. 33-52)
- Christian Ghasarian, Rendement et qualité du travail dans les chantiers du bâtiment. Un regard ethnographique, (pp. 53-68)
- Pierre Jeanneret, Le travail paysan dans les Montagnes du Chablais vaudois, (pp. 69-73)
- Les représentations du travail
- Régis Huguenin, Voir le travail : les photographies d’ouvriers et d’ouvrières de l’entreprise Suchard de Neuchâtel-Serrières, (pp. 75-94)
- Laurence Marti, Ouvriers des trente glorieuses. Le travail dans l’industrie de la machine-outil à Moutier, (pp. 95-112)
- Les enjeux du travail
- Francesco Garufo, Ces pères tranquilles de la haute conjoncture : les travailleurs frontaliers dans l’horlogerie suisse (1945-1980), (pp. 113-130)
- Aline Burki et Leana Ebel, Quels enjeux l’embauche de femmes immigrées en Suisse représente-t-elle dans le cadre d’une politique d’emploi sexuée ? L’exemple de l’horlogerie, 1946-1962, (pp.131-153)
- Claude Cantini (avec une présentation de Michel Busch), Grèves !, (pp. 154-163)
- Charles Heimberg, Mourir d’amiante, un drame social décalé, (pp. 164-172)
- Chroniques (pp. 173-179)
- Pierre-Yves Donzé, Archives d’entreprises et histoire du travail industriel. L’exemple jurassien
- Interviews vidéo réalisés par Pierre Jeanneret
- Comptes rendus (pp. 181-191)
